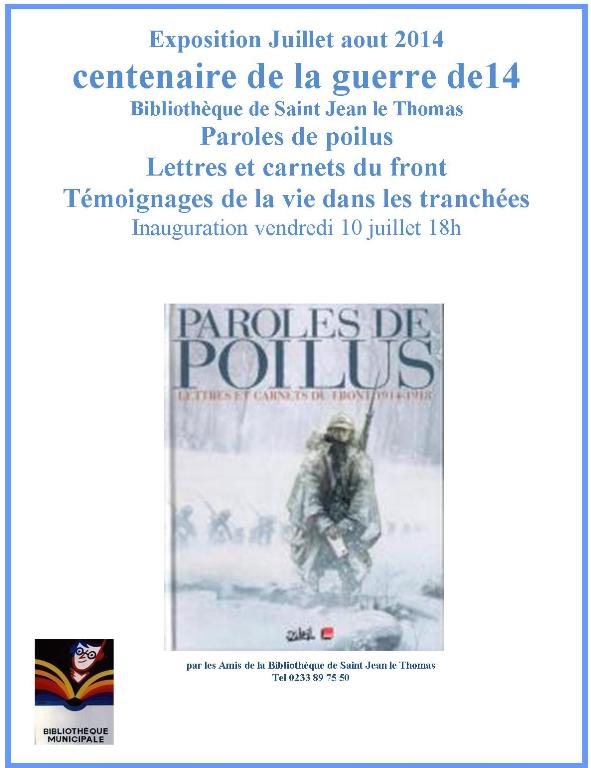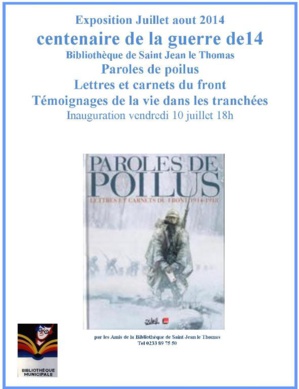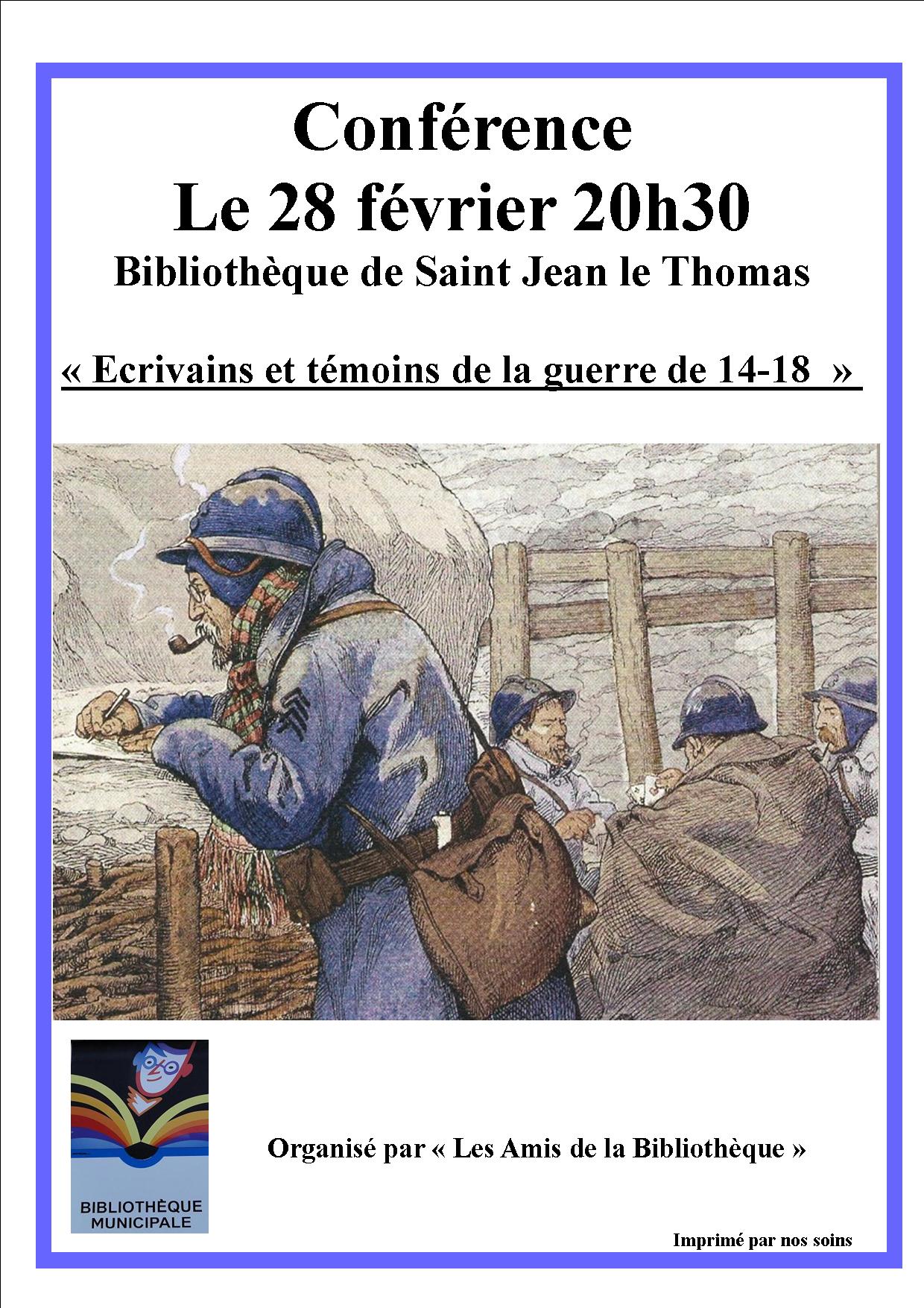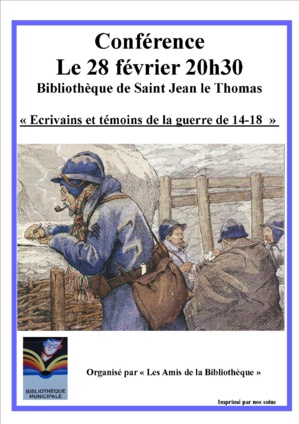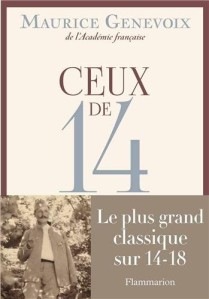I -Remarques préliminaires sur la lecture et l’écriture pendant la Grande Guerre
On a beaucoup écrit entre 1914 et 1918, que ce soit des cartes postales, des lettres (les fameuses babilleuses ou babillardes), des notes, carnets, des reportages et chroniques de guerre, des récits journalistiques, plus ou moins inventés, et bien sûr, l’objet de mon étude ici: des récits plus ou moins romanesques.
Diverses raisons à ce foisonnement d’écriture :
Avec l’école de Jules Ferry, la France savait lire et écrire (- de 4% des conscrits étaient illétrés), et les hommes du front, les poilus, n’avaient guère que ce moyen, en dehors des permissions, de communiquer avec l’arrière dont, comme vous le savez, ils étaient coupés. Ainsi entre 1914 et 1918, “4 millions de lettres étaient expédiées quotidiennement depuis la zone des armées vers l’arrière et autant y parvenait.” (1)
Le courrier était gratuit, le service postal très efficace (et cela dès le début de la guerre) et les soldats encouragés à écrire (pour remonter le “moral des troupes” et aussi pour permettre au gouvernement de tester ce moral car, bien sûr, tout ce qui passait par le système postal était soumis à la censure et rien n’était privé). Mais même si le temps et les conditions de cette correspondance entre le front et l’arrière étaient sévèrement limités, on voit bien, dans les romans qui se déroulent sur le front, que l’arrivée du vaguemestre est une des deux grandes causes de réjouissance de la journée avec l’arrivée du cuistot (de la soupe, du pinard et du “jus”). Pour nous, maintenant que les derniers témoins de la guerre des tranchées ont disparu (le Français Lazare Ponticelli, en 2008 et le “Tommy” Harry Patch, en 2009), ces documents sont devenus extrêmement précieux. Ces documents écrits dont la fonction principale était la communication, ont pour nous fonction de mémoire, et c’est intéressant et touchant de voir, lire, déchiffrer ces cartes et ces lettres que les familles de toute la France en ce moment sont en train de ressortir de leurs greniers, conservées pieusement ou par inadvertance, et qui, même si l’on sait qu’on n’en retrouvera qu’une partie et qu’elles ne peuvent ou ne veulent pas tout dire, nous offrent un témoignage vivant d’une époque à jamais disparue.
Donc je rends hommage à ceux qui ont préparé et contribué à l’effort de mémoire vivante des soldats disparus il y a maintenant une centaine d’années. Et vous renvoie, en particulier, à l’exposition de ces documents, dans la bibliothèque de Saint Jean-le-Thomas (où vous trouverez, entre autres, les “Souvenirs de ma captivité” de Joseph Beaudor, les carnets de guerre de Christophe Merlaud, avec d’extraordinaires dessins et aquarelles inédits, le Mémorial de la paroisse de St. Jean-Le-Thomas de l’abbé Barbot pendant la guerre, et des lettres de poilus comme celles de Georges Debost). (2) Ces lettres des poilus et les lettres aux poilus nous offrent une vision inclusive et pour la plupart fiable (malgré la censure) de la guerre, à la fois du front et de l’arrière. Elles complémentent et compensent en quelque sorte les récits romancés du front qui, comme on le verra, ont tendance à tomber dans les clichés, les stéréotypes, les personnages typiques, les scènes obligées, et souvent le sentimentalisme et la bonne conscience.
Elles nous étonnent pourtant par leur côté pratique. Si le soldat du front, coupé de l’arrière, écrit tant c’est aussi qu’il est concerné par la vie qui doit se dérouler sans lui, donne des nouvelles, des conseils aux parents, aux épouses, etc., (on le voit dans les lettres qu’Elina Leproux, agricultrice à Fontclaireau, écrit régulièrement à son mari François) car il faut bien que la vie continue, que le foin soit rentré et les vignes cueillies, le bétail vendu à la foire, le cheval nourri: “Bibi [le cheval] va bien, on ne l’entend plus tousser” (écrit Elina à François, le 26 novembre 1915). De même l’arrière, coupé du front, est avide d’avoir des nouvelles du mari, du fils, du père, du cousin, de l’amant, etc., mais aussi des conseils, un soutien. Et les lettres circulent: comme cette lettre de François à Elina: “J’ai reçu une carte de Pierre. Il est content que ça fasse beau temps. Il dit qu’il se trouve joli de ne pas être couvert de boue”, datée du 8 mai 1915. (3)
A ces raisons qui expliquent le foisonnement d’écriture pendant la guerre, il faut ajouter une raison majeure dans notre système capitaliste et opportuniste: la raison économique. Car la guerre, qui perturbe les habitudes, fait aussi fonctionner la machine économique. La curiosité générale de l’arrière pour le front, donne lieu à une démultiplication de reportages, récits de guerre, cartes postales toutes faites (comme celle sur le poster, ou les nombreuses cartes de bâtiments détruits), photo-montages, et tout cela fait admirablement marcher le commerce journalistique, la presse et l’imprimerie, et toutes les industries de culture populaire. Il n’y a presse et l’imprimerie, et toutes les industries de culture populaire. Il n’y a pas de guerre sans un marché de la guerre et l’écriture se vend bien. Encore aujourd’hui, si l’on entre dans une librairie, on voit tout de suite surgir un rayon plein de livres tout récemment écrits sur la Grande Guerre ou d’ouvrages que l’on ressort et republie pour l’occasion. Et dieu sait combien de feuilles noircies par les journalistes (les quatorze volumes de la chronique quotidienne de Maurice Barrès dans La Revue de Paris, pour ne citer que cet exemple) sont passés aux oubliettes.
Pourquoi ces trois romans?
D’abord parce que je n’ai pas le temps de vous parler de tous les romans écrits sur fond de Grande Guerre (il y en a eu beaucoup, et pas des meilleurs), mais aussi parce que ce sont les plus intéressants et qu’ils ont survécu à l’épreuve du temps. Publiés entre 1916 (au moment où les esprits devenaient moins cocardiers et optimistes) et 1919, ils ont plus d’une caractéristiques en commun. (5)
Diverses raisons à ce foisonnement d’écriture :
Avec l’école de Jules Ferry, la France savait lire et écrire (- de 4% des conscrits étaient illétrés), et les hommes du front, les poilus, n’avaient guère que ce moyen, en dehors des permissions, de communiquer avec l’arrière dont, comme vous le savez, ils étaient coupés. Ainsi entre 1914 et 1918, “4 millions de lettres étaient expédiées quotidiennement depuis la zone des armées vers l’arrière et autant y parvenait.” (1)
Le courrier était gratuit, le service postal très efficace (et cela dès le début de la guerre) et les soldats encouragés à écrire (pour remonter le “moral des troupes” et aussi pour permettre au gouvernement de tester ce moral car, bien sûr, tout ce qui passait par le système postal était soumis à la censure et rien n’était privé). Mais même si le temps et les conditions de cette correspondance entre le front et l’arrière étaient sévèrement limités, on voit bien, dans les romans qui se déroulent sur le front, que l’arrivée du vaguemestre est une des deux grandes causes de réjouissance de la journée avec l’arrivée du cuistot (de la soupe, du pinard et du “jus”). Pour nous, maintenant que les derniers témoins de la guerre des tranchées ont disparu (le Français Lazare Ponticelli, en 2008 et le “Tommy” Harry Patch, en 2009), ces documents sont devenus extrêmement précieux. Ces documents écrits dont la fonction principale était la communication, ont pour nous fonction de mémoire, et c’est intéressant et touchant de voir, lire, déchiffrer ces cartes et ces lettres que les familles de toute la France en ce moment sont en train de ressortir de leurs greniers, conservées pieusement ou par inadvertance, et qui, même si l’on sait qu’on n’en retrouvera qu’une partie et qu’elles ne peuvent ou ne veulent pas tout dire, nous offrent un témoignage vivant d’une époque à jamais disparue.
Donc je rends hommage à ceux qui ont préparé et contribué à l’effort de mémoire vivante des soldats disparus il y a maintenant une centaine d’années. Et vous renvoie, en particulier, à l’exposition de ces documents, dans la bibliothèque de Saint Jean-le-Thomas (où vous trouverez, entre autres, les “Souvenirs de ma captivité” de Joseph Beaudor, les carnets de guerre de Christophe Merlaud, avec d’extraordinaires dessins et aquarelles inédits, le Mémorial de la paroisse de St. Jean-Le-Thomas de l’abbé Barbot pendant la guerre, et des lettres de poilus comme celles de Georges Debost). (2) Ces lettres des poilus et les lettres aux poilus nous offrent une vision inclusive et pour la plupart fiable (malgré la censure) de la guerre, à la fois du front et de l’arrière. Elles complémentent et compensent en quelque sorte les récits romancés du front qui, comme on le verra, ont tendance à tomber dans les clichés, les stéréotypes, les personnages typiques, les scènes obligées, et souvent le sentimentalisme et la bonne conscience.
Elles nous étonnent pourtant par leur côté pratique. Si le soldat du front, coupé de l’arrière, écrit tant c’est aussi qu’il est concerné par la vie qui doit se dérouler sans lui, donne des nouvelles, des conseils aux parents, aux épouses, etc., (on le voit dans les lettres qu’Elina Leproux, agricultrice à Fontclaireau, écrit régulièrement à son mari François) car il faut bien que la vie continue, que le foin soit rentré et les vignes cueillies, le bétail vendu à la foire, le cheval nourri: “Bibi [le cheval] va bien, on ne l’entend plus tousser” (écrit Elina à François, le 26 novembre 1915). De même l’arrière, coupé du front, est avide d’avoir des nouvelles du mari, du fils, du père, du cousin, de l’amant, etc., mais aussi des conseils, un soutien. Et les lettres circulent: comme cette lettre de François à Elina: “J’ai reçu une carte de Pierre. Il est content que ça fasse beau temps. Il dit qu’il se trouve joli de ne pas être couvert de boue”, datée du 8 mai 1915. (3)
A ces raisons qui expliquent le foisonnement d’écriture pendant la guerre, il faut ajouter une raison majeure dans notre système capitaliste et opportuniste: la raison économique. Car la guerre, qui perturbe les habitudes, fait aussi fonctionner la machine économique. La curiosité générale de l’arrière pour le front, donne lieu à une démultiplication de reportages, récits de guerre, cartes postales toutes faites (comme celle sur le poster, ou les nombreuses cartes de bâtiments détruits), photo-montages, et tout cela fait admirablement marcher le commerce journalistique, la presse et l’imprimerie, et toutes les industries de culture populaire. Il n’y a presse et l’imprimerie, et toutes les industries de culture populaire. Il n’y a pas de guerre sans un marché de la guerre et l’écriture se vend bien. Encore aujourd’hui, si l’on entre dans une librairie, on voit tout de suite surgir un rayon plein de livres tout récemment écrits sur la Grande Guerre ou d’ouvrages que l’on ressort et republie pour l’occasion. Et dieu sait combien de feuilles noircies par les journalistes (les quatorze volumes de la chronique quotidienne de Maurice Barrès dans La Revue de Paris, pour ne citer que cet exemple) sont passés aux oubliettes.
- Le roman poilu
Et cela fait aussi marcher le roman, genre très populaire au 19e siècle, et qui va connaître un renouveau de succès avec des oeuvres telles Le Feu (de Henri Barbusse, 1916, 250 000 exemplaires vendus pendant la guerre), Ceux de 14 (Maurice Genevoix, 1916-23) et Les Croix de bois (Roland Dorgelès, 1919) pour ne citer que les plus célèbres et dont je propose de parler ici, trois romans-témoignages de “poilus”, de combattants du front, écrivant en plein milieu de la guerre leur expérience des tranchées, des combats, de leurs rapports avec les villes ou villages occupés ou simplement traversés. (4)
C’est sur ces romans de guerre, écrits pendant la guerre même, et qui connurent d’énormes succès de librairie, que je voudrais m’arrêter. Pourquoi ces trois romans?
D’abord parce que je n’ai pas le temps de vous parler de tous les romans écrits sur fond de Grande Guerre (il y en a eu beaucoup, et pas des meilleurs), mais aussi parce que ce sont les plus intéressants et qu’ils ont survécu à l’épreuve du temps. Publiés entre 1916 (au moment où les esprits devenaient moins cocardiers et optimistes) et 1919, ils ont plus d’une caractéristiques en commun. (5)
-Ce sont des romans à la première personne, basés sur l’expérience du front , et ceci est leur point commun principal, ce sont des récits de témoins, d’écrivains combattants
-des romans basés non pas sur l’individu mais le groupe
-non sur le héros mais la collectivité, et en particulier l’escouade (15 hommes)
-non sur la volonté et l’optimisme mais sur le sentiment d’impuissance
-non sur la bourgeoisie et les classes privilégiées mais sur le peuple des villes et des compagnes confondus.
-Enfin, ils ont une autre chose en commun: pas ou peu de femmes.
Bien sûr, car dans les tranchées, il n’y en avait pas, et sur le front, il n’y avait guère que celles que l’on rencontrait dans les villages occupés par les troupes, ou qui composaient le service sanitaire et hospitalier, les belles dames auréolées de leurs voiles blancs, les “dames en blanc”.
Les femmes étaient à l’arrière, et l’arrière, comme je l’ai dit, était coupé de l’avant, du front. Le roman du front offre donc un portrait de groupe sans dames (pour parodier le fameux Portrait de groupe avec dame de Heinrich Böll, 1972). Et, depuis La Chanson de Roland (XIIe siècle), c’est une nouveauté.
On voit en effet que cette littérature se départage radicalement de tout ce qui a précédé en France où il y a une forte tradition romanesque, et une tradition où la femme a toujours joué un rôle primordial, soit en tant que sujet principal du roman, de La Princesse de Clèves (Mme de Lafayette, 1672) à La Vagabonde (Colette, 1910), en passant bien sûr par Madame Bovary (1957) et tout le 19e siècle, soit en tant que lectrice, grande consommatrice de romans et, de plus en plus, en faisant exception de la période de la guerre, productrice elle-même de romans.
Or, ici, comme je l’ai dit, par la force des choses, point de femmes. Ou plutôt, comme je vais vous le montrer, si peu, si stéréotypées et uni-dimensionelles (si carte postale) surtout si on les compare aux grandes figures féminines de la littérature française, que force est de nous tourner vers les lettres et documents iconographiques si l’on veut avoir une perspective un peu plus pleine et vivante de la femme. Ou encore, attendre deux décennies pour voir, avec Céline (Voyage au bout de la nuit, 1932), Drieu la Rochelle (La comédie de Charleroi, 1934) et Giono (Le grand troupeau, 1937), pour ne citer que ces trois grands romanciers des années 30, des portraits de femmes qui sortent décidément du stéréotype, ce qui ne veut pas dire, loin de là, qu’ils soient toujours flatteurs pour la gente féminine.
-des romans basés non pas sur l’individu mais le groupe
-non sur le héros mais la collectivité, et en particulier l’escouade (15 hommes)
-non sur la volonté et l’optimisme mais sur le sentiment d’impuissance
-non sur la bourgeoisie et les classes privilégiées mais sur le peuple des villes et des compagnes confondus.
-Enfin, ils ont une autre chose en commun: pas ou peu de femmes.
Bien sûr, car dans les tranchées, il n’y en avait pas, et sur le front, il n’y avait guère que celles que l’on rencontrait dans les villages occupés par les troupes, ou qui composaient le service sanitaire et hospitalier, les belles dames auréolées de leurs voiles blancs, les “dames en blanc”.
Les femmes étaient à l’arrière, et l’arrière, comme je l’ai dit, était coupé de l’avant, du front. Le roman du front offre donc un portrait de groupe sans dames (pour parodier le fameux Portrait de groupe avec dame de Heinrich Böll, 1972). Et, depuis La Chanson de Roland (XIIe siècle), c’est une nouveauté.
On voit en effet que cette littérature se départage radicalement de tout ce qui a précédé en France où il y a une forte tradition romanesque, et une tradition où la femme a toujours joué un rôle primordial, soit en tant que sujet principal du roman, de La Princesse de Clèves (Mme de Lafayette, 1672) à La Vagabonde (Colette, 1910), en passant bien sûr par Madame Bovary (1957) et tout le 19e siècle, soit en tant que lectrice, grande consommatrice de romans et, de plus en plus, en faisant exception de la période de la guerre, productrice elle-même de romans.
Or, ici, comme je l’ai dit, par la force des choses, point de femmes. Ou plutôt, comme je vais vous le montrer, si peu, si stéréotypées et uni-dimensionelles (si carte postale) surtout si on les compare aux grandes figures féminines de la littérature française, que force est de nous tourner vers les lettres et documents iconographiques si l’on veut avoir une perspective un peu plus pleine et vivante de la femme. Ou encore, attendre deux décennies pour voir, avec Céline (Voyage au bout de la nuit, 1932), Drieu la Rochelle (La comédie de Charleroi, 1934) et Giono (Le grand troupeau, 1937), pour ne citer que ces trois grands romanciers des années 30, des portraits de femmes qui sortent décidément du stéréotype, ce qui ne veut pas dire, loin de là, qu’ils soient toujours flatteurs pour la gente féminine.
Barbusse, Dorgelès, Genevoix (6)
A. Le corps féminin sur le champ de bataille
Lorsque Apollinaire écrit dans ses Poèmes à Lou (Louise de Coligny-Chatillon qu’il rencontre en 1914), “Et tu me baises sur le Front”, la phrase est bien sûr à double entente car sous le baiser chaste sur le front, il y a, moins chastement, le fantasme du soldat au front qui rêve de la présence bien charnelle d’une femme, d’un baisage plutôt que d’un baiser. Et s’il en rêve c’est bien sûr qu’elle n’a pas, physiquement, sa place au front, encore moins dans la tranchée. Elle a si peu sa place que le corps de la femme morte (objet de prédilection de la littérature romantique avec ses Ophélie et ses Atala) est un sujet de scandale et d’incrédulité.
Voici un passage où Hemingway (dans Le Vainqueur ne gagne rien, publié en 1933), raconte ses réactions lors d’une expédition de ramassage de cadavres après l’explosion d’une usine de munitions (nous sommes en juin 1918), Hemingway était brancardier :
Lorsque Apollinaire écrit dans ses Poèmes à Lou (Louise de Coligny-Chatillon qu’il rencontre en 1914), “Et tu me baises sur le Front”, la phrase est bien sûr à double entente car sous le baiser chaste sur le front, il y a, moins chastement, le fantasme du soldat au front qui rêve de la présence bien charnelle d’une femme, d’un baisage plutôt que d’un baiser. Et s’il en rêve c’est bien sûr qu’elle n’a pas, physiquement, sa place au front, encore moins dans la tranchée. Elle a si peu sa place que le corps de la femme morte (objet de prédilection de la littérature romantique avec ses Ophélie et ses Atala) est un sujet de scandale et d’incrédulité.
Voici un passage où Hemingway (dans Le Vainqueur ne gagne rien, publié en 1933), raconte ses réactions lors d’une expédition de ramassage de cadavres après l’explosion d’une usine de munitions (nous sommes en juin 1918), Hemingway était brancardier :
En ce qui concerne le sexe des morts, il est certain qu’on s’habitue tellement à voir des cadavres d’hommes que la vue d’une femme morte est tout à fait choquante. J’ai constaté pour la première fois cette interversion du sexe habituel des morts après l’explosion d’une fabrique de munitions dans la campagne, aux environs de Milan […]
Arrivés à ce qui avait été la fabrique, on envoya une partie des hommes patrouiller parmi les énormes stocks de munitions qui, pour une raison ou une autre, n’avaient pas explosé, tandis que le reste avait pour tâche […] de fouiller le voisinage immédiat et les champs environnants à la recherche des cadavres. Nous en trouvâmes et transportâmes un bon nombre dans une morgue improvisée, et je dois bien admettre que ce fut un choc de constater que la plupart étaient des femmes. A cette époque-là, les femmes ne portaient pas encore les cheveux courts, comme ce fut la mode plus tard, en Europe et en Amérique […] et ce fut la mode plus tard, en Europe et en Amérique […] et l’impression la plus gênante—sans doute parce que c’était un cas exceptionnel—était la présence, et peut-être plus troublante encore, l’absence de ces longs cheveux (italiques dans le texte, souligné par moi). (7)
Si j’ai cité ce passage c’est qu’il m’intéresse à cause de la question du poil. Comme il est souvent noté dans les textes écrits par ou à propos des “poilus” (terme qui existait pourtant avant la guerre de 14-18), le poil du poilu, surtout couvert de la boue des tranchées, symbolise le retour de l’homme à l’animal). Et si le terme poilu existait avant la guerre de 14-18 pour désigner un soldat hirsute, ce n’est qu’en 1915, année où la guerre se fige dans les tranchées, où le poil se couvre de boue, cette matière informe qui elle aussi évoque le retour à une origine, que l’image prend. (8)
Opposé au poil est le cheveu, en particulier celui de la femme, du côté de la beauté, de la parure et de l’érotisme, et aussi de la civilisation. En principe, la femelle de la race civilise le mâle, on trouve déjà cette idée dans le plus ancien texte de la littérature mondiale, L’épopée de Gilgamesh (datant du 20e siècle environ avant J.C.), où un jeune homme, Enkidu, couvert de poils et qui parle le langage des animaux, perd ses poils (et son rapport avec le monde animal) après une semaine entière passée à faire l’amour avec la séduisante Shamhat. Si la femme et ses longs cheveux est le principe civilisateur, on peut dire, au moment où Hemingway écrit ces lignes (1918), qu’on assiste à la fin d’un tel monde.
En effet, le choc, la gêne, le trouble, pour Hemingway n’est pas seulement de constater tant de morts qu’il fallait transporter à la morgue (on s’habitue, dit-il, à voir des cadavres d’hommes”) et que c’étaient presque toutes des femmes (c’est normal, après tout, pour une usine de munitions), mais de constater l’absence des longs cheveux des femmes (avant que la mode ne produise des “garçonnes” comme on appellera les femmes à cheveux coupés court). (le roman de Victor Margueritte, La Garçonne, publié en 1920, a produit un énorme succès de scandale et la perte de la légion d’honneur à son auteur, en partie parce qu’il décrivait une femme qui avait osé se couper les cheveux et vivre “en garçon”, c’est-à-dire en renversant les rôles masculins/féminins).
Avant la mode, la mort, la mort moderne, produite ici par ce qu’Hemingway appelle, “la terrifiante énergie des explosifs à grande puissance”, en transformant le corps en charpie, efface les différences sexuelles :
je me rappelle qu’après avoir ramassé tous les cadavres entiers, nous commençâmes à recueillir les morceaux épars. Nous en détachâmes beaucoup de l’épais grillage de barbelés qui avait entouré l’usine, et sur les restes desquels nous ramassions des lambeaux de chair. (Ibid.)
Et pourtant, dans son irréalité, parce qu’il n’y avait pas de blessés, le caractère horrible de cette catastrophe était moins pénible, pour Hemingway et ses camarades brancardiers, que, dit-il, “notre expérience habituelle des champs de bataille”. C’est dire ce qu’avait d’inimaginable et d’indescriptible l’expérience des champs de bataille. Ou comme le dit simplement Georges Debost dans une lettre écrite au tout début de la guerre, le 4 septembre 1914, “Il faut voir pour se rendre compte de ce que c’est que la guerre”. (9)
Arrivés à ce qui avait été la fabrique, on envoya une partie des hommes patrouiller parmi les énormes stocks de munitions qui, pour une raison ou une autre, n’avaient pas explosé, tandis que le reste avait pour tâche […] de fouiller le voisinage immédiat et les champs environnants à la recherche des cadavres. Nous en trouvâmes et transportâmes un bon nombre dans une morgue improvisée, et je dois bien admettre que ce fut un choc de constater que la plupart étaient des femmes. A cette époque-là, les femmes ne portaient pas encore les cheveux courts, comme ce fut la mode plus tard, en Europe et en Amérique […] et ce fut la mode plus tard, en Europe et en Amérique […] et l’impression la plus gênante—sans doute parce que c’était un cas exceptionnel—était la présence, et peut-être plus troublante encore, l’absence de ces longs cheveux (italiques dans le texte, souligné par moi). (7)
Si j’ai cité ce passage c’est qu’il m’intéresse à cause de la question du poil. Comme il est souvent noté dans les textes écrits par ou à propos des “poilus” (terme qui existait pourtant avant la guerre de 14-18), le poil du poilu, surtout couvert de la boue des tranchées, symbolise le retour de l’homme à l’animal). Et si le terme poilu existait avant la guerre de 14-18 pour désigner un soldat hirsute, ce n’est qu’en 1915, année où la guerre se fige dans les tranchées, où le poil se couvre de boue, cette matière informe qui elle aussi évoque le retour à une origine, que l’image prend. (8)
Opposé au poil est le cheveu, en particulier celui de la femme, du côté de la beauté, de la parure et de l’érotisme, et aussi de la civilisation. En principe, la femelle de la race civilise le mâle, on trouve déjà cette idée dans le plus ancien texte de la littérature mondiale, L’épopée de Gilgamesh (datant du 20e siècle environ avant J.C.), où un jeune homme, Enkidu, couvert de poils et qui parle le langage des animaux, perd ses poils (et son rapport avec le monde animal) après une semaine entière passée à faire l’amour avec la séduisante Shamhat. Si la femme et ses longs cheveux est le principe civilisateur, on peut dire, au moment où Hemingway écrit ces lignes (1918), qu’on assiste à la fin d’un tel monde.
En effet, le choc, la gêne, le trouble, pour Hemingway n’est pas seulement de constater tant de morts qu’il fallait transporter à la morgue (on s’habitue, dit-il, à voir des cadavres d’hommes”) et que c’étaient presque toutes des femmes (c’est normal, après tout, pour une usine de munitions), mais de constater l’absence des longs cheveux des femmes (avant que la mode ne produise des “garçonnes” comme on appellera les femmes à cheveux coupés court). (le roman de Victor Margueritte, La Garçonne, publié en 1920, a produit un énorme succès de scandale et la perte de la légion d’honneur à son auteur, en partie parce qu’il décrivait une femme qui avait osé se couper les cheveux et vivre “en garçon”, c’est-à-dire en renversant les rôles masculins/féminins).
Avant la mode, la mort, la mort moderne, produite ici par ce qu’Hemingway appelle, “la terrifiante énergie des explosifs à grande puissance”, en transformant le corps en charpie, efface les différences sexuelles :
je me rappelle qu’après avoir ramassé tous les cadavres entiers, nous commençâmes à recueillir les morceaux épars. Nous en détachâmes beaucoup de l’épais grillage de barbelés qui avait entouré l’usine, et sur les restes desquels nous ramassions des lambeaux de chair. (Ibid.)
Et pourtant, dans son irréalité, parce qu’il n’y avait pas de blessés, le caractère horrible de cette catastrophe était moins pénible, pour Hemingway et ses camarades brancardiers, que, dit-il, “notre expérience habituelle des champs de bataille”. C’est dire ce qu’avait d’inimaginable et d’indescriptible l’expérience des champs de bataille. Ou comme le dit simplement Georges Debost dans une lettre écrite au tout début de la guerre, le 4 septembre 1914, “Il faut voir pour se rendre compte de ce que c’est que la guerre”. (9)
Revenons donc aux champs de bataille, et à la place des femmes. Voici ma thèse:
Dans un monde si bouleversé, qui sépare les hommes des femmes, où les hommes retournent à l’état sauvage et les femmes disparaissent, dans un monde où il est urgent d´écrire, de témoigner, mais d’une expérience qu’on ne comprend pas et qu’on n’arrive pas à décrire, il n’est pas étonnant que survivent les aspects les moins réalistes de la littérature: les fantasmes et les stéréotypes, et dans un monde entre hommes, que ce soit les femmes qui soient particulièrement sujettes aux fantasmes et stéréotypes.
Donc je propose d’aborder la question de la femme dans le roman de la Grande Guerre en étudiant les fantasmes et stéréotypes la concernant, et en vous citant de larges passages de mes trois romanciers poilus. On verra ensuite ce qu’on peut en conclure.
Dans un monde si bouleversé, qui sépare les hommes des femmes, où les hommes retournent à l’état sauvage et les femmes disparaissent, dans un monde où il est urgent d´écrire, de témoigner, mais d’une expérience qu’on ne comprend pas et qu’on n’arrive pas à décrire, il n’est pas étonnant que survivent les aspects les moins réalistes de la littérature: les fantasmes et les stéréotypes, et dans un monde entre hommes, que ce soit les femmes qui soient particulièrement sujettes aux fantasmes et stéréotypes.
Donc je propose d’aborder la question de la femme dans le roman de la Grande Guerre en étudiant les fantasmes et stéréotypes la concernant, et en vous citant de larges passages de mes trois romanciers poilus. On verra ensuite ce qu’on peut en conclure.

Henri Barbusse
B. Stéréotypes
Deux types de femmes se détachent:
La femme idéalisée et la femme vilifiée, en gros la maman et la putain, comme dans le film de Jean Eustache (sorti en 1973) qui met en scène un jeune héros, Alexandre, joué par Jean-Pierre Léaud, qui s’accommode parfaitement de cette double “nature” fémine et forme un ménage à trois avec Veronika (Françoise Lebrun), l’infirmière, la maman, et Marie (Bernadette Lafont), la créatrice de mode, la putain.
-Idéal
Dans le roman de la GG, typiquement idéalisées sont la mère, l’infirmière et la marraine de guerre pour leur côté maternel: abnégation de soi, dons d’amour mais aussi de biens matériels, colis, lettres, etc. Mais elles apparaissent peu dans la littérature, alors que, comme on l’a noté, ce n’est pas le cas dans la correspondance réelle où (avec les soeurs, les tantes, les cousines, les amies et bien sûr les célèbres “marrainnes de guerre”), elles jouent un rôle primordial d’interlocutrices.
La mère, c’est elle que le soldat, retourné au stade de l’enfant dépourvu de secours, blessé sur le champ de bataille, sachant qu’il va mourir, appelle lamentablement. Nombreuses sont les scènes, dans le roman de la guerre, où le fils mourant appelle “maman”. Un des épisodes les plus pathétiques se trouve dans Les Croix de bois de Dorgelès, où un blessé abandonné devant la tranchée, un soldat inconnu de l’escouade, appelle à intervalles réguliers pour qu’on vienne le secourir, plainte qui devient de plus en plus imperceptible, sauf pour une jeune recrue, Gilbert, qui l’écoute avec angoisse, compte les secondes entre chaque plainte atroce du “blessé inconnu”, qui finit par expirer à bout d’argument en évoquant sa mère:
-…. Me chercher…. J’ai une moman, les copains, j’ai une moman.
Et il prononçait “Moman” comme les gosses de Paris. (Les Croix, 302)
La mère dans le roman est aussi celle à qui le poilu cache la vérité de sa situation ou encore, plus subtilement, se la cache à lui-même comme dans Le Feu de Barbusse, où la lettre écrite en toute bonne foi par un des poilus à sa mère, la rassurant en lui disant qu’ils ne s’en font pas au front, qu’ils sont bien en sécurité, est démentie par sa mort quelques jours plus tard. Si bien que cette lettre, confiée au narrateur, ne parviendra jamais à sa destination car il aurait été trop cruel de l’envoyer. Mais elle servira à renforcer l’argument de Barbusse contre l’absurdité.
La mère peut aussi être celle qui comprend tout, qui devine tout, et faute de pouvoir être utile à son propre enfant, parti au front, offrira tout au soldat de passage qui lui rappelle son fils. C’est le cas de la bonne Mme Aubry, dans Ceux de 14 de Genevoix, qui, avec sa fille, la Thérèse, tout aussi généreuse que sa mère, offrira le logis à Genevoix et son ami Porchon :
Elle nous regarde avec une bienveillance presque maternelle. Ses traits sont fins, sous des cheveux d’un blond terni restés très abondants et souples. Ses yeux bleus ont une douceur un peu triste; et leurs prunelles pleines de lumière gardent à tout le visage, dont la chair pâle s’est fanée, une expression de jeunesse candide.
La fille, elle, n’est que jeunesse: plus petite un peu que sa mère,
les cheveux plus brillants et bruns, elle a les mêmes yeux de lumière, aux iris larges, d’un bleu à la fois intense et limpide. La fraîcheur de son teint, d’un blanc un peu doré de hâle, enchante de sa pure perfection. Comme sa mère, elle sourit, entrouvrant ses lèvres vermeilles sur des incisives courtes, à l’émail net, et dont les deux plus grands, en haut, s’écartent un peu l’une de l’autre. (Ceux de 14, 319)
Double portrait d’une même femme: mère maternelle-fille vierge pure.
Ces caractéristiques physiques évoquent la bonté, la générosité et la pitié.
Dans Les Croix de bois, dans un chapitre intitulé “Notre-Dame des biffins”, c’est la vierge Marie qui incarne l’espoir insensé de tous les biffins, celui de vivre, celle à qui les soldats s’adressent pour qu’elle intervienne auprès d’un dieu sans pitié.
La scène suivante, une messe de dimanche, à la veille d’une attaque qui
s’avèrera particulièrement mortifère, réunit croyants et incroyants:
Pas un chandelier sur l’autel, le tabernacle même a été enlevé. Il ne reste plus que la Vierge en robe bleue piquée d’étoiles, un bouquet de paquerettes à ses pieds. Notre-Dame des biffins. Elle étend ses deux mains, deux petites mains roses de plâtre peint, deux mains toutes-puissantes qui sauvent qui la prie. Ils ne croient pas tous, ces soldats désoeuvrés, mais tous croient à ses mains, ils veulent y croire aveuglément, pour se sentir défendus, protégés. (Ceux de 14, 186)
[…] Nous acceptons tout: les relèves sous la pluie, les nuits dans la boue, les jours sans pain, la fatigue surhumaine qui nous fait plus brutes que les bêtes, nous acceptons toutes les souffrances, mais laissez-nous vivre, rien que cela, vivre… Ou seulement le croire jusqu’au bout, espérer toujours, espérer quand même. (Ceux de 14, 188)
La religion ici, sans les chandeliers et les tabernacles, retourne à l’essentiel: l’espoir, insensé, de vivre.
Deux types de femmes se détachent:
La femme idéalisée et la femme vilifiée, en gros la maman et la putain, comme dans le film de Jean Eustache (sorti en 1973) qui met en scène un jeune héros, Alexandre, joué par Jean-Pierre Léaud, qui s’accommode parfaitement de cette double “nature” fémine et forme un ménage à trois avec Veronika (Françoise Lebrun), l’infirmière, la maman, et Marie (Bernadette Lafont), la créatrice de mode, la putain.
-Idéal
Dans le roman de la GG, typiquement idéalisées sont la mère, l’infirmière et la marraine de guerre pour leur côté maternel: abnégation de soi, dons d’amour mais aussi de biens matériels, colis, lettres, etc. Mais elles apparaissent peu dans la littérature, alors que, comme on l’a noté, ce n’est pas le cas dans la correspondance réelle où (avec les soeurs, les tantes, les cousines, les amies et bien sûr les célèbres “marrainnes de guerre”), elles jouent un rôle primordial d’interlocutrices.
La mère, c’est elle que le soldat, retourné au stade de l’enfant dépourvu de secours, blessé sur le champ de bataille, sachant qu’il va mourir, appelle lamentablement. Nombreuses sont les scènes, dans le roman de la guerre, où le fils mourant appelle “maman”. Un des épisodes les plus pathétiques se trouve dans Les Croix de bois de Dorgelès, où un blessé abandonné devant la tranchée, un soldat inconnu de l’escouade, appelle à intervalles réguliers pour qu’on vienne le secourir, plainte qui devient de plus en plus imperceptible, sauf pour une jeune recrue, Gilbert, qui l’écoute avec angoisse, compte les secondes entre chaque plainte atroce du “blessé inconnu”, qui finit par expirer à bout d’argument en évoquant sa mère:
-…. Me chercher…. J’ai une moman, les copains, j’ai une moman.
Et il prononçait “Moman” comme les gosses de Paris. (Les Croix, 302)
La mère dans le roman est aussi celle à qui le poilu cache la vérité de sa situation ou encore, plus subtilement, se la cache à lui-même comme dans Le Feu de Barbusse, où la lettre écrite en toute bonne foi par un des poilus à sa mère, la rassurant en lui disant qu’ils ne s’en font pas au front, qu’ils sont bien en sécurité, est démentie par sa mort quelques jours plus tard. Si bien que cette lettre, confiée au narrateur, ne parviendra jamais à sa destination car il aurait été trop cruel de l’envoyer. Mais elle servira à renforcer l’argument de Barbusse contre l’absurdité.
La mère peut aussi être celle qui comprend tout, qui devine tout, et faute de pouvoir être utile à son propre enfant, parti au front, offrira tout au soldat de passage qui lui rappelle son fils. C’est le cas de la bonne Mme Aubry, dans Ceux de 14 de Genevoix, qui, avec sa fille, la Thérèse, tout aussi généreuse que sa mère, offrira le logis à Genevoix et son ami Porchon :
Elle nous regarde avec une bienveillance presque maternelle. Ses traits sont fins, sous des cheveux d’un blond terni restés très abondants et souples. Ses yeux bleus ont une douceur un peu triste; et leurs prunelles pleines de lumière gardent à tout le visage, dont la chair pâle s’est fanée, une expression de jeunesse candide.
La fille, elle, n’est que jeunesse: plus petite un peu que sa mère,
les cheveux plus brillants et bruns, elle a les mêmes yeux de lumière, aux iris larges, d’un bleu à la fois intense et limpide. La fraîcheur de son teint, d’un blanc un peu doré de hâle, enchante de sa pure perfection. Comme sa mère, elle sourit, entrouvrant ses lèvres vermeilles sur des incisives courtes, à l’émail net, et dont les deux plus grands, en haut, s’écartent un peu l’une de l’autre. (Ceux de 14, 319)
Double portrait d’une même femme: mère maternelle-fille vierge pure.
Ces caractéristiques physiques évoquent la bonté, la générosité et la pitié.
Dans Les Croix de bois, dans un chapitre intitulé “Notre-Dame des biffins”, c’est la vierge Marie qui incarne l’espoir insensé de tous les biffins, celui de vivre, celle à qui les soldats s’adressent pour qu’elle intervienne auprès d’un dieu sans pitié.
La scène suivante, une messe de dimanche, à la veille d’une attaque qui
s’avèrera particulièrement mortifère, réunit croyants et incroyants:
Pas un chandelier sur l’autel, le tabernacle même a été enlevé. Il ne reste plus que la Vierge en robe bleue piquée d’étoiles, un bouquet de paquerettes à ses pieds. Notre-Dame des biffins. Elle étend ses deux mains, deux petites mains roses de plâtre peint, deux mains toutes-puissantes qui sauvent qui la prie. Ils ne croient pas tous, ces soldats désoeuvrés, mais tous croient à ses mains, ils veulent y croire aveuglément, pour se sentir défendus, protégés. (Ceux de 14, 186)
[…] Nous acceptons tout: les relèves sous la pluie, les nuits dans la boue, les jours sans pain, la fatigue surhumaine qui nous fait plus brutes que les bêtes, nous acceptons toutes les souffrances, mais laissez-nous vivre, rien que cela, vivre… Ou seulement le croire jusqu’au bout, espérer toujours, espérer quand même. (Ceux de 14, 188)
La religion ici, sans les chandeliers et les tabernacles, retourne à l’essentiel: l’espoir, insensé, de vivre.
-Réalité
A l’opposé de cette image idéalisée de la mère, il y a la femme dans ses divers états de réalisme un peu grossier. D’ailleurs la scène qui suit directement celle de Notre-Dame des biffins, toujours dans Les Croix de bois, nous fait redescendre sur terre, et jeter un regard amusé sur les “filles” du village qui sortent de la messe sous le regard des soldats:
Rangés sur deux rangs, les soldats regardaient sortir les filles, de fortes dondons aux corsages voyants, les joues astiquées comme pour une revue de détail, qui riaient et parlaient fort, pour se donner le genre de Paris. Des yeux goulus les convoitaient et des compliments saluaient les plus belles.
La fille du maire, chafouine et chlorotique, était partie les yeux baissés, avec la demoiselle des postes, une jeune fille légère en robe noire comme une vendeuse de magasin, qui marchait d’un pas dansant et devait mettre un brin de poudre, sur des joues mates.
Bourland, en la voyant, était devenu tout rouge et elle lui avait souri.
-On la filoche? proposa Surphart [le petit rigolo de la troupe] qui, tondu de frais, de croyait invincible. (Les Croix, 188)
Sous la plume humoristique de Dorgelès, et le regard des soldats, le groupe de femmes prend quelques contours en formes d’oppositions. Du troupeau de femmes aux joues astiquées comme pour une revue militaire, se distingue la demoiselle des postes, dont les joues mates sont couvertes d’un brin de poudre, et dont la démarche légère, la robe noire, évoquent Paris et ses aguicheuses demoiselles de magasin. Ici, on a tout l’arrière chic et élégant entrevu dans ce personnage. La femme, pour le permissionnaire, envoyé rejoindre la civilisation juste l’espace de quelques jours, est une créature dansante, évanescente, en mouvement dans la ville. C’est d’ailleurs parce qu’elle n’est qu’entrevue qu’elle est jolie, “les têtes sont toujours jolies, qu’on n’entrevoit qu’un instant” (Les Croix, 234).
De telles femmes, il faut ajouter, font exception dans le monde de laideur qui est celui du front, et c’est peut-être aussi bien parce que les hommes ne sont pas tentés, ou comme le dit crûment Mollette, un soldat du Feu: “Les femmes ici […] a sont laides, c’est des r’mèdes” (Le Feu, 124).
Cette femme dansante qui fait rougir l’un et provoque la remarque grossière d’un autre, forme un contraste parfait avec une autre figure, dangereuse elle-aussi, mais pour d’autres raisons: la femme chafouine et chlorotique, qui n’attire les regards de personne, et qui garde les yeux baissés sur des secrets ou des projets inavouables.
Ici on voit une autre figure stéréotypée de la femme: celle en qui on ne peut avoir confiance, l’opposée de la mère, soit parce qu’elle est intéressée par l’argent (la bonne mère au contraire se saigne aux quatre veines, comme on dit, pour envoyer des douceurs à son fils), mais pire la femme espionne, la femme par qui finalement le mal arrive, et dont il faut toujours se méfier, surtout si elle a le regard fuyant ou les yeux baissés.
A l’opposé de cette image idéalisée de la mère, il y a la femme dans ses divers états de réalisme un peu grossier. D’ailleurs la scène qui suit directement celle de Notre-Dame des biffins, toujours dans Les Croix de bois, nous fait redescendre sur terre, et jeter un regard amusé sur les “filles” du village qui sortent de la messe sous le regard des soldats:
Rangés sur deux rangs, les soldats regardaient sortir les filles, de fortes dondons aux corsages voyants, les joues astiquées comme pour une revue de détail, qui riaient et parlaient fort, pour se donner le genre de Paris. Des yeux goulus les convoitaient et des compliments saluaient les plus belles.
La fille du maire, chafouine et chlorotique, était partie les yeux baissés, avec la demoiselle des postes, une jeune fille légère en robe noire comme une vendeuse de magasin, qui marchait d’un pas dansant et devait mettre un brin de poudre, sur des joues mates.
Bourland, en la voyant, était devenu tout rouge et elle lui avait souri.
-On la filoche? proposa Surphart [le petit rigolo de la troupe] qui, tondu de frais, de croyait invincible. (Les Croix, 188)
Sous la plume humoristique de Dorgelès, et le regard des soldats, le groupe de femmes prend quelques contours en formes d’oppositions. Du troupeau de femmes aux joues astiquées comme pour une revue militaire, se distingue la demoiselle des postes, dont les joues mates sont couvertes d’un brin de poudre, et dont la démarche légère, la robe noire, évoquent Paris et ses aguicheuses demoiselles de magasin. Ici, on a tout l’arrière chic et élégant entrevu dans ce personnage. La femme, pour le permissionnaire, envoyé rejoindre la civilisation juste l’espace de quelques jours, est une créature dansante, évanescente, en mouvement dans la ville. C’est d’ailleurs parce qu’elle n’est qu’entrevue qu’elle est jolie, “les têtes sont toujours jolies, qu’on n’entrevoit qu’un instant” (Les Croix, 234).
De telles femmes, il faut ajouter, font exception dans le monde de laideur qui est celui du front, et c’est peut-être aussi bien parce que les hommes ne sont pas tentés, ou comme le dit crûment Mollette, un soldat du Feu: “Les femmes ici […] a sont laides, c’est des r’mèdes” (Le Feu, 124).
Cette femme dansante qui fait rougir l’un et provoque la remarque grossière d’un autre, forme un contraste parfait avec une autre figure, dangereuse elle-aussi, mais pour d’autres raisons: la femme chafouine et chlorotique, qui n’attire les regards de personne, et qui garde les yeux baissés sur des secrets ou des projets inavouables.
Ici on voit une autre figure stéréotypée de la femme: celle en qui on ne peut avoir confiance, l’opposée de la mère, soit parce qu’elle est intéressée par l’argent (la bonne mère au contraire se saigne aux quatre veines, comme on dit, pour envoyer des douceurs à son fils), mais pire la femme espionne, la femme par qui finalement le mal arrive, et dont il faut toujours se méfier, surtout si elle a le regard fuyant ou les yeux baissés.
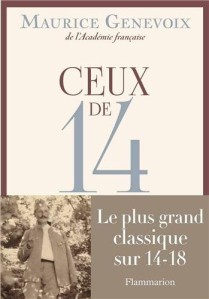
M. Genevoix - Ceux de 14
La femme intéressée
Cette femme intéressée et qui tire profit de la guerre, on la rencontre à tous les détours des romans de la guerre de 14-18, lorsque le soldat sort de la tranchée et se cherche un gîte et un couvert pour la nuit. C’est celle qu’on rencontre dans un village du front, envahi par les troupes, villages meurtris, pillés, brûlés, mais dont les survivants tirent le meilleur parti de la pire des situations.
Dans Ceux de 14, Genevoix établit clairement l’opposition entre le portrait idéal de la mère-fille Aubry qui agissent par charité et désintérêt envers les soldats de passage, et les divers portraits de la femme qui fait la même chose mais par intérêt. Il y a un portrait terrible d’une vieille femme qui vend des oeufs à prix d’or, décrite par les soldats comme une sorte de sorcière :
Alors on dit un prix, un gros prix. C’est magique: les bras éplorés retombent, la voix glapissante baisse d’une octave; puis la mégère glisse à pas feutrés le long du couloir jonché de crottes de poules, courbe son grand corps en passant sous une porte basse, émerge avec précaution, cachant on ne sait quoi dans le creux de son tablier. Et quand elle est tout contre vous, six oeufs à la file apparaissent de ses doigts maigres, laiteux sur sa peau terreuse. Elle vous les coule, tièdes encore, dans les mains, au fond des poches; et elle dit tout bas, de sa bouche aux gencives nues:
N’faut point en causer, sutout. J’en aurais p’t’être d’aut’s pour vous, quand mes gélines les auront faits. Mais n’faut point en causer. Oh! mais non, là. (Ceux de 14, 129)
Cette femme intéressée et qui tire profit de la guerre, on la rencontre à tous les détours des romans de la guerre de 14-18, lorsque le soldat sort de la tranchée et se cherche un gîte et un couvert pour la nuit. C’est celle qu’on rencontre dans un village du front, envahi par les troupes, villages meurtris, pillés, brûlés, mais dont les survivants tirent le meilleur parti de la pire des situations.
Dans Ceux de 14, Genevoix établit clairement l’opposition entre le portrait idéal de la mère-fille Aubry qui agissent par charité et désintérêt envers les soldats de passage, et les divers portraits de la femme qui fait la même chose mais par intérêt. Il y a un portrait terrible d’une vieille femme qui vend des oeufs à prix d’or, décrite par les soldats comme une sorte de sorcière :
Alors on dit un prix, un gros prix. C’est magique: les bras éplorés retombent, la voix glapissante baisse d’une octave; puis la mégère glisse à pas feutrés le long du couloir jonché de crottes de poules, courbe son grand corps en passant sous une porte basse, émerge avec précaution, cachant on ne sait quoi dans le creux de son tablier. Et quand elle est tout contre vous, six oeufs à la file apparaissent de ses doigts maigres, laiteux sur sa peau terreuse. Elle vous les coule, tièdes encore, dans les mains, au fond des poches; et elle dit tout bas, de sa bouche aux gencives nues:
N’faut point en causer, sutout. J’en aurais p’t’être d’aut’s pour vous, quand mes gélines les auront faits. Mais n’faut point en causer. Oh! mais non, là. (Ceux de 14, 129)

Roland Dorgeles
Dans Les Croix de bois, la femme n’a quasiment jamais le beau rôle. Comme on l’a vu, Dorgelès peut être aussi féroce que Flaubert décrivant ses paysans normands:
[l’épicière], la mère Bouquet, une femme énorme, se défend à son comptoir contre vingt mains avides.
-Il n’y a plus de sardines… trente-deux sous le camembert! … si vous n’en voulez pas, laissez-le, on a la vente… n’allez pas tripoter tout comme ça, tas de dégoûtants.
L’épicière se démène, crie et ne sert personne, ne pensant qu’à écarter les mains qui se tendent, de peur qu’on ne lui vole quelque chose.
-Y a plus rien, j’vous dis… Allez-vous-en… Lucie! Viens fermer la porte… Ils vont tout casser, les saligauds.
Mais Lucie, la fille de la patronne, ne bouge pas: elle n’aime pas les saligauds. Un sautoir en argent sur son corsage empesé, ses cheveux fades ondulés en papillottes, elle reste, hautaine, dans la petite salle du fond, aussi fière sur son tabouret, entre le portrait du général Joffre et le tableau des pièces à refuser, qu’une grue débutante dans son taxi. (Les Croix, 112-3)
Dorgelès ne fait pas dans la dentelle, on le voit. Lucie, désirée de tous les soldats, ne daigne regarder que les gradés ou les soldats “bien”, ceux qui s’achètent des denrées nobles, comme du chocolat et de l’eau de Cologne. A ceux-là elle dit “Monsieur”, minaude, en servant le vin, vin que sa mère fait maintenant payer bien plus cher depuis qu’elle l’a bouché.
Telle mère telle fille.
Pire que ce rôle de quasi-prostituée, Dorgelès n’hésite pas à donner le rôle d’espionne à la fille d’une famille de paysans chez qui le narrateur et son escouade sont logés.
En fait, le père et la fille sont de mèche, la fille écoutant sans en avoir l’air ce que les soldats racontent devant elle, et le père transmettant par des signaux émis du grenier les informations relayées par sa fille.
Tel père telle fille.
Dans les deux cas, le tableau de la femme est noirci, les contours simplifiés. Ce qui est souligné, surtout chez Dorgelès, est le manque de confiance dans la femme, le soupçon, quelquefois intolérable, de son manque de fidélité. Et c’est aussi la cruauté qui en résulte, mais qui affecte plus le père que la fille. Le père ne se remettra pas d’avoir causé la mort de soldats qui lui rappellent son fils, mort dans les tranchées, et se suicidera de honte et de tristesse. Rien de tel chez la fille dont l’impassibilité ne sera jamais atteinte, et qui continuera son travail mortifère d’espionne.
[l’épicière], la mère Bouquet, une femme énorme, se défend à son comptoir contre vingt mains avides.
-Il n’y a plus de sardines… trente-deux sous le camembert! … si vous n’en voulez pas, laissez-le, on a la vente… n’allez pas tripoter tout comme ça, tas de dégoûtants.
L’épicière se démène, crie et ne sert personne, ne pensant qu’à écarter les mains qui se tendent, de peur qu’on ne lui vole quelque chose.
-Y a plus rien, j’vous dis… Allez-vous-en… Lucie! Viens fermer la porte… Ils vont tout casser, les saligauds.
Mais Lucie, la fille de la patronne, ne bouge pas: elle n’aime pas les saligauds. Un sautoir en argent sur son corsage empesé, ses cheveux fades ondulés en papillottes, elle reste, hautaine, dans la petite salle du fond, aussi fière sur son tabouret, entre le portrait du général Joffre et le tableau des pièces à refuser, qu’une grue débutante dans son taxi. (Les Croix, 112-3)
Dorgelès ne fait pas dans la dentelle, on le voit. Lucie, désirée de tous les soldats, ne daigne regarder que les gradés ou les soldats “bien”, ceux qui s’achètent des denrées nobles, comme du chocolat et de l’eau de Cologne. A ceux-là elle dit “Monsieur”, minaude, en servant le vin, vin que sa mère fait maintenant payer bien plus cher depuis qu’elle l’a bouché.
Telle mère telle fille.
Pire que ce rôle de quasi-prostituée, Dorgelès n’hésite pas à donner le rôle d’espionne à la fille d’une famille de paysans chez qui le narrateur et son escouade sont logés.
En fait, le père et la fille sont de mèche, la fille écoutant sans en avoir l’air ce que les soldats racontent devant elle, et le père transmettant par des signaux émis du grenier les informations relayées par sa fille.
Tel père telle fille.
Dans les deux cas, le tableau de la femme est noirci, les contours simplifiés. Ce qui est souligné, surtout chez Dorgelès, est le manque de confiance dans la femme, le soupçon, quelquefois intolérable, de son manque de fidélité. Et c’est aussi la cruauté qui en résulte, mais qui affecte plus le père que la fille. Le père ne se remettra pas d’avoir causé la mort de soldats qui lui rappellent son fils, mort dans les tranchées, et se suicidera de honte et de tristesse. Rien de tel chez la fille dont l’impassibilité ne sera jamais atteinte, et qui continuera son travail mortifère d’espionne.

Raymond Radiguet
La promise et l’épouse
La promise ou l’épouse figure pauvrement dans ces premiers romans et récits: sauf dans des cas exceptionnels, elle est inconstante, faible, oublieuse, et dans les pires des cas, profite de l’absence du mari ou du fiancé pour prendre un amant, ce qui mène, si le mari revient et qu’un enfant nait de leur liaison, à la trahison suprême: le batard de guerre, produit ou non avec l’ennemi. Les trois romans sont pleins de ces personnages, que l’on trouve d’ailleurs dans Le diable du corps de Raymond Radiguet (1923), où la femme du soldat meurt en accouchant d’un garçon à qui elle donne le nom de son jeune amant de 15 ans, François. Le secret est gardé mais la femme, plus que le jeune homme qui a suivi ses instincts, a trahi le mari parti au front, doublement trahi car il ne saura jamais que son fils n’est pas son fils.
La promise ou l’épouse figure pauvrement dans ces premiers romans et récits: sauf dans des cas exceptionnels, elle est inconstante, faible, oublieuse, et dans les pires des cas, profite de l’absence du mari ou du fiancé pour prendre un amant, ce qui mène, si le mari revient et qu’un enfant nait de leur liaison, à la trahison suprême: le batard de guerre, produit ou non avec l’ennemi. Les trois romans sont pleins de ces personnages, que l’on trouve d’ailleurs dans Le diable du corps de Raymond Radiguet (1923), où la femme du soldat meurt en accouchant d’un garçon à qui elle donne le nom de son jeune amant de 15 ans, François. Le secret est gardé mais la femme, plus que le jeune homme qui a suivi ses instincts, a trahi le mari parti au front, doublement trahi car il ne saura jamais que son fils n’est pas son fils.
Nombreux sont les exemples d’amies infidèles.
Dans Les Croix de bois, Gilbert Demachy, un jeune parisien de famille bourgeoise, naïf et généreux, un de ces nombreux “puceaux de l’horreur”, comme les appelle Céline, un “bleu” qui débarque dans un bataillon sans imaginer ce qui l’attend, est rapidement déniaisé, du moins en ce qui concerne son dépucelage au front. Par contre, il reste romantiquement attaché à l’idée que la jeune fille qu’il a rencontrée avant de partir, et dont il attend fiévreusement les lettres, attendra son retour:
-A quoi penses-tu, Gilbert, le cafard?
-Non, souvenirs…
Et il parle tout bas, de loin, comme si le passé le gardait.
-L’an dernier, jour pour jour, j’arrivais à Agay. C’était le matin.
Je me souviens que près de la gare, on brûlait un beau tas vert d’eucalyptus ou de pin dont l’âcre fumée piquait l’air d’un parfum sauvage. Elle me disait que cela la faisait tousser. Elle portait une robe bleue, bleue pervenche…
Puis il se força un peu pour rire:
-Maintenant, c’est moi qui suis en bleu. C’est la guerre…. (Les Croix, 119).
C’est la guerre, et comme on peut s’y attendre, Gilbert ne survivra pas à la dernière lettre qu’il reçoit et dans laquelle la jeune fille lui raconte sa rencontre avec un jeune homme, leur randonnée dans les Alpes, précisément là où ils avaient été ensemble, au Mal Infernet, “le Mal Infernet, tu te souviens”, ajoute-t-elle en retournant le couteau dans la plaie.
Voici un extrait de la scène finale, où on comprend bien pourquoi Gilbert prend tous les risques et finit par mourir de blessures qui ne sont pas toutes physiques, et qu’il associe avec celles du blessé inconnu qui toute la nuit a appelé sa mère “môman”. Comme lui, il se sent trahi, abandonné, ignoré des brancardiers :
Dans sa tête obscurcie, il confondait les deux mamans: la sienne et celle que le mourant avait appelée toute une nuit… Laquelle était la sienne?
Pour lutter contre le sommeil et la mort qui le gagne, il se met à chanter:
Vlà l’beau temps
Ture-lure-lure
Vlà l’beau temps
Pourvu que ça dure
Et finit par mourir, sous la pluie, confondue avec ses pleurs, lui-même noyant son chagrin dans le plus large chagrin du monde:
La pluie ruisselait en pleurs le long de ses joues maigries. Puis deux lourdes larmes coulèrent de ses yeux creux, les deux dernières… (Les Croix, 321)
Dans Les Croix de bois, Gilbert Demachy, un jeune parisien de famille bourgeoise, naïf et généreux, un de ces nombreux “puceaux de l’horreur”, comme les appelle Céline, un “bleu” qui débarque dans un bataillon sans imaginer ce qui l’attend, est rapidement déniaisé, du moins en ce qui concerne son dépucelage au front. Par contre, il reste romantiquement attaché à l’idée que la jeune fille qu’il a rencontrée avant de partir, et dont il attend fiévreusement les lettres, attendra son retour:
-A quoi penses-tu, Gilbert, le cafard?
-Non, souvenirs…
Et il parle tout bas, de loin, comme si le passé le gardait.
-L’an dernier, jour pour jour, j’arrivais à Agay. C’était le matin.
Je me souviens que près de la gare, on brûlait un beau tas vert d’eucalyptus ou de pin dont l’âcre fumée piquait l’air d’un parfum sauvage. Elle me disait que cela la faisait tousser. Elle portait une robe bleue, bleue pervenche…
Puis il se força un peu pour rire:
-Maintenant, c’est moi qui suis en bleu. C’est la guerre…. (Les Croix, 119).
C’est la guerre, et comme on peut s’y attendre, Gilbert ne survivra pas à la dernière lettre qu’il reçoit et dans laquelle la jeune fille lui raconte sa rencontre avec un jeune homme, leur randonnée dans les Alpes, précisément là où ils avaient été ensemble, au Mal Infernet, “le Mal Infernet, tu te souviens”, ajoute-t-elle en retournant le couteau dans la plaie.
Voici un extrait de la scène finale, où on comprend bien pourquoi Gilbert prend tous les risques et finit par mourir de blessures qui ne sont pas toutes physiques, et qu’il associe avec celles du blessé inconnu qui toute la nuit a appelé sa mère “môman”. Comme lui, il se sent trahi, abandonné, ignoré des brancardiers :
Dans sa tête obscurcie, il confondait les deux mamans: la sienne et celle que le mourant avait appelée toute une nuit… Laquelle était la sienne?
Pour lutter contre le sommeil et la mort qui le gagne, il se met à chanter:
Vlà l’beau temps
Ture-lure-lure
Vlà l’beau temps
Pourvu que ça dure
Et finit par mourir, sous la pluie, confondue avec ses pleurs, lui-même noyant son chagrin dans le plus large chagrin du monde:
La pluie ruisselait en pleurs le long de ses joues maigries. Puis deux lourdes larmes coulèrent de ses yeux creux, les deux dernières… (Les Croix, 321)
Les maris ou époux légitimes ne sont pas mieux lotis.
Dans Les Croix de bois également, le personnage du caporal Bréval passe son temps à attendre anxieusement une lettre de sa femme et sa mort préfigure celle du jeune homme:
Quand un nom rappelait le sien, il faisait répéter:
-C’est pas pour moi, des fois? Caporal Bréval…
Mais ce n’était jamais pour lui, et tournant vers nous son pauvre visage gêné, il expliquait:
-Elle écrit si mal, hein, ça n’aurait rien de drôle. (Les Croix, 21)
Bien sûr, on l’aura compris, sa femme non seulement le trompe mais se met en ménage avec son amant et lorsqu’il meurt au cours de l’attaque finale, dans les bras de Gilbert, on a une grande scène sur le modèle du Père Goriot, où tour à tour, l’homme maudit la femme qui l’a trahi, puis lui pardonne pour épargner leur petite fille, pour de nouveau la maudire :
Et puis non! Je ne veux pas… Ecoute, Gilbert, au nom du bon Dieu, je te demande d’aller à Rouen. Il faut que tu y ailles!...Tu me le jures. Et tu lui diras que c’est à cause d’elle que je suis crevé… Il faut que tu lui dises… Et tu le diras à tout le monde, que c’est une salope, qu’elle faisait la vie pendant que j’étais au front… Je la maudis, t’entends et je voudrais qu’elle crève comme moi, avec son type… tu lui diras que je lui ai craché à la figure avant de mourir, tu lui diras…
Il tendait son maigre visage, terrible, un peu de bave rouge au coin des lèvres. Blême, Gilbert cherchait à l’apaiser. Il l’avait pris par le cou, très doucement, et voulait le coucher…
Allons vieux, ne pleure pas, répétait-il d’une voix que les larmes contenues éraillaient… Ne pleure pas, tu n’es que blessé.
Et il caressait pieusement la maigre tête qui pleurait. (Les Croix, 251-2)
Dans un coin Sulphart, le petit rigolo de la bande, sanglote, et le lieutenant Morache, en général plutôt vache et autoritaire, retient ses larmes, mais on voit ses lèvres et son menton trembler.
La fin de Bréval est décrite comme l’agonie du Christ aux bras de sa mère, Gilbert, dans le rôle de la Pieta, le berçant tout en essuyant doucement l’écume de sa bouche:
Et comme s’il avait cru lui garder encore un instant de vie en le cachant à Celle qui emporte les morts, Gilbert le serrait contre sa poitrine, sa joue contre sa joue, les mains sous ses épaules, et pleurant sur son front. (Les Croix, 253)
Dans le genre pathétique, on ne fait guère mieux.
Dans Les Croix de bois également, le personnage du caporal Bréval passe son temps à attendre anxieusement une lettre de sa femme et sa mort préfigure celle du jeune homme:
Quand un nom rappelait le sien, il faisait répéter:
-C’est pas pour moi, des fois? Caporal Bréval…
Mais ce n’était jamais pour lui, et tournant vers nous son pauvre visage gêné, il expliquait:
-Elle écrit si mal, hein, ça n’aurait rien de drôle. (Les Croix, 21)
Bien sûr, on l’aura compris, sa femme non seulement le trompe mais se met en ménage avec son amant et lorsqu’il meurt au cours de l’attaque finale, dans les bras de Gilbert, on a une grande scène sur le modèle du Père Goriot, où tour à tour, l’homme maudit la femme qui l’a trahi, puis lui pardonne pour épargner leur petite fille, pour de nouveau la maudire :
Et puis non! Je ne veux pas… Ecoute, Gilbert, au nom du bon Dieu, je te demande d’aller à Rouen. Il faut que tu y ailles!...Tu me le jures. Et tu lui diras que c’est à cause d’elle que je suis crevé… Il faut que tu lui dises… Et tu le diras à tout le monde, que c’est une salope, qu’elle faisait la vie pendant que j’étais au front… Je la maudis, t’entends et je voudrais qu’elle crève comme moi, avec son type… tu lui diras que je lui ai craché à la figure avant de mourir, tu lui diras…
Il tendait son maigre visage, terrible, un peu de bave rouge au coin des lèvres. Blême, Gilbert cherchait à l’apaiser. Il l’avait pris par le cou, très doucement, et voulait le coucher…
Allons vieux, ne pleure pas, répétait-il d’une voix que les larmes contenues éraillaient… Ne pleure pas, tu n’es que blessé.
Et il caressait pieusement la maigre tête qui pleurait. (Les Croix, 251-2)
Dans un coin Sulphart, le petit rigolo de la bande, sanglote, et le lieutenant Morache, en général plutôt vache et autoritaire, retient ses larmes, mais on voit ses lèvres et son menton trembler.
La fin de Bréval est décrite comme l’agonie du Christ aux bras de sa mère, Gilbert, dans le rôle de la Pieta, le berçant tout en essuyant doucement l’écume de sa bouche:
Et comme s’il avait cru lui garder encore un instant de vie en le cachant à Celle qui emporte les morts, Gilbert le serrait contre sa poitrine, sa joue contre sa joue, les mains sous ses épaules, et pleurant sur son front. (Les Croix, 253)
Dans le genre pathétique, on ne fait guère mieux.

H. Barbusse - Le Feu
Dans Le Feu, Barbusse est un peu moins larmoyant, et moins féroce pour les femmes qui trompent leurs maris en profitant de la guerre qui les envoie au front (lui-même avait une femme à qui il écrivait tous les jours) et son personnage de cocu, Poterloo, est plus nuancé.
Celui-ci qu’il appelle “son frère d’armes”, se confie à lui: par un étrange concours de circonstances, il a pu voir, sans être vu, sa femme Clotilde assise à table entre deux sous-officiers allemands :
Et quoi qu’elle faisait? Rien: elle souriait, en penchant gentiment sa figure entourée d’un léger petit cadre de cheveux blonds où la lampe mettait de la dorure.
Pas un sourire forcé, pas un sourire qui paye, non, un vrai sourire, qui venait d’elle, et qu’elle donnait. E pendant l’temps d’un éclair que j’ai passé dans les deux sens, j’ai pu voir aussi ma gosse qui tendait les mains vers un gros bonhomme galonné et essayait de lui monter sur les genoux, et puis, à côté, qui donc ça que j’reconnaissais? C’était Madeleine Vandaërt, la femme de Vandaërt, mon copain de la 19e, qui a été tué à la Marne, à Montyon.
Elle le savait qu’il avait été tué, puisqu’elle était en deuil. Et elle, elle rigolait, elle riait carrément, j’te l’dis… et elle regardait l’un et l’autre avec un air de dire.: “Comme j’suis bien ici!” (Le Feu, 227-8)
Alors quoi, conclut-il, il suffit qu’on soit pas là pendant un temps pour qu’on ne compte plus? Tu fous le camp de chez toi pour aller à la guerre, et tout a l’air cassé; et pendant que tu l’crois, on se fait à ton absence, et peu à peu tu deviens comme si tu n’étais pas, vu qu’on s’passe de toi pour être heureuse comme avant et pour sourire. (Le Feu, 228)
Et pourtant, ce qui est admirable chez Barbusse c’est qu’il n’oublie jamais son message anti-guerre et son adhésion enthousiaste à la vie. C’est moins la femme que le brave Poterloo blâme que la guerre :
Elle est toute jeune, tu sais; ça a vingt-six ans. Elle ne peut pas r’tenir sa jeunesse. Ça lui sort de partout et quand elle se repose à la lampe et au chaud, elle est bien obligée de sourire. (230)
C’est kif-kif la gosse qui, quand elle se trouve à côté d’un bonhomme qui ne parle pas de l’envoyer baller, finit par chercher à lui monter sur les genoux. Elle aimerait peut-être mieux que ce soit son oncle ou un ami de son père--p’têt--mais elle essaie tout de même auprès de celui qui est seul à être là, même si c’est un gros cochon à lunettes. Le Feu, 231)
Barbusse ici anticipe Giono, qui lui aussi écrira un roman qui se veut un réquisitoire contre la guerre: la guerre est anti-nature et la femme, même celle comme le personnage de Julia, dans Le grand troupeau (1931), est elle aussi victime de la guerre, peut-être de façon plus fondamentale car Giono la place du côté de la vie même, vie que la guerre a complètement assassinée. La chute même de Julia avec Toine, le déserteur, est à mettre sur le compte de ce grand désir de vie qui “lui sort de partout” et qui lui sera pardonné, à la fin du roman, lorsque le monde aura rétabli la paix, l’ordre et la vie.
Celui-ci qu’il appelle “son frère d’armes”, se confie à lui: par un étrange concours de circonstances, il a pu voir, sans être vu, sa femme Clotilde assise à table entre deux sous-officiers allemands :
Et quoi qu’elle faisait? Rien: elle souriait, en penchant gentiment sa figure entourée d’un léger petit cadre de cheveux blonds où la lampe mettait de la dorure.
Pas un sourire forcé, pas un sourire qui paye, non, un vrai sourire, qui venait d’elle, et qu’elle donnait. E pendant l’temps d’un éclair que j’ai passé dans les deux sens, j’ai pu voir aussi ma gosse qui tendait les mains vers un gros bonhomme galonné et essayait de lui monter sur les genoux, et puis, à côté, qui donc ça que j’reconnaissais? C’était Madeleine Vandaërt, la femme de Vandaërt, mon copain de la 19e, qui a été tué à la Marne, à Montyon.
Elle le savait qu’il avait été tué, puisqu’elle était en deuil. Et elle, elle rigolait, elle riait carrément, j’te l’dis… et elle regardait l’un et l’autre avec un air de dire.: “Comme j’suis bien ici!” (Le Feu, 227-8)
Alors quoi, conclut-il, il suffit qu’on soit pas là pendant un temps pour qu’on ne compte plus? Tu fous le camp de chez toi pour aller à la guerre, et tout a l’air cassé; et pendant que tu l’crois, on se fait à ton absence, et peu à peu tu deviens comme si tu n’étais pas, vu qu’on s’passe de toi pour être heureuse comme avant et pour sourire. (Le Feu, 228)
Et pourtant, ce qui est admirable chez Barbusse c’est qu’il n’oublie jamais son message anti-guerre et son adhésion enthousiaste à la vie. C’est moins la femme que le brave Poterloo blâme que la guerre :
Elle est toute jeune, tu sais; ça a vingt-six ans. Elle ne peut pas r’tenir sa jeunesse. Ça lui sort de partout et quand elle se repose à la lampe et au chaud, elle est bien obligée de sourire. (230)
C’est kif-kif la gosse qui, quand elle se trouve à côté d’un bonhomme qui ne parle pas de l’envoyer baller, finit par chercher à lui monter sur les genoux. Elle aimerait peut-être mieux que ce soit son oncle ou un ami de son père--p’têt--mais elle essaie tout de même auprès de celui qui est seul à être là, même si c’est un gros cochon à lunettes. Le Feu, 231)
Barbusse ici anticipe Giono, qui lui aussi écrira un roman qui se veut un réquisitoire contre la guerre: la guerre est anti-nature et la femme, même celle comme le personnage de Julia, dans Le grand troupeau (1931), est elle aussi victime de la guerre, peut-être de façon plus fondamentale car Giono la place du côté de la vie même, vie que la guerre a complètement assassinée. La chute même de Julia avec Toine, le déserteur, est à mettre sur le compte de ce grand désir de vie qui “lui sort de partout” et qui lui sera pardonné, à la fin du roman, lorsque le monde aura rétabli la paix, l’ordre et la vie.
Mais retournons au Feu, où on a également une sorte d’exception de la mauvaise femme en la personne de Mariette, la femme du narrateur, au nom d’Eudore, qui nous raconte cette histoire touchante d’une permission tant attendue mais au cours de laquelle, au lieu d’en profiter pour savourer une bonne nuit de sexe et de nourriture pieusement mise de côté par la femme, le couple, d’un commun accord, choisit par générosité de donner l’hospitalité à des camarades d’escouade errant et sans abris (il tombe des trombes d’eau et la maison n’a qu’une pièce). Le jeune couple, qui attendait la permission depuis 15 mois, passe la nuit à s’entre dévorer des yeux :
Mariette et moi, on n’a pas dormi. On s’est regardés, mais on regardait aussi les autres, qui nous regardaient, et voilà.
Le matin est venu débarbouiller la fenêtre. Je me suis levé pour aller voir le temps. La pluie n’avait guère diminué. Dans la chambre, je voyais des formes brunes qui bougeaient, respiraient fort. Mariette avait les yeux rouges de m’avoir regardé toute la nuit. Entre elle et moi, un poilu, bourrait une pipe. (Le Feu, 156)
A la fin, parce qu’elle est femme et désireuse d’avantager son mari sur les autres, elle glisse en secret dans sa musette un jambon, une miche de pain et une bouteille de vin, en faisant promettre à son cher époux de ne pas les partager avec les autres, ce qu’il s’empresse bien sûr de faire, parce qu’après tout, en temps de guerre, tout (sauf la femme) se partage :
Pauv’ Mariette, soupire Eudore. Y avait quinze mois que je ne l’avais vue. Et quand est-ce que je la reverrai! Et est-ce que je la reverrai?
-C’était gentil, c’t’idée qu’elle avait. Elle me fourra tout ça dans ma musette…
Il entrouve sa musette de toile bise.
-Tenez, les v’là: l’jambon ici et là le grignotage, et v’là l’kilo. Eh bien, puisque c’est là, vous ne savez pas ce qu’on va faire? Nous allons nous partager ça, hein, mes vieux poteaux? (Le Feu, 158)
Mariette et moi, on n’a pas dormi. On s’est regardés, mais on regardait aussi les autres, qui nous regardaient, et voilà.
Le matin est venu débarbouiller la fenêtre. Je me suis levé pour aller voir le temps. La pluie n’avait guère diminué. Dans la chambre, je voyais des formes brunes qui bougeaient, respiraient fort. Mariette avait les yeux rouges de m’avoir regardé toute la nuit. Entre elle et moi, un poilu, bourrait une pipe. (Le Feu, 156)
A la fin, parce qu’elle est femme et désireuse d’avantager son mari sur les autres, elle glisse en secret dans sa musette un jambon, une miche de pain et une bouteille de vin, en faisant promettre à son cher époux de ne pas les partager avec les autres, ce qu’il s’empresse bien sûr de faire, parce qu’après tout, en temps de guerre, tout (sauf la femme) se partage :
Pauv’ Mariette, soupire Eudore. Y avait quinze mois que je ne l’avais vue. Et quand est-ce que je la reverrai! Et est-ce que je la reverrai?
-C’était gentil, c’t’idée qu’elle avait. Elle me fourra tout ça dans ma musette…
Il entrouve sa musette de toile bise.
-Tenez, les v’là: l’jambon ici et là le grignotage, et v’là l’kilo. Eh bien, puisque c’est là, vous ne savez pas ce qu’on va faire? Nous allons nous partager ça, hein, mes vieux poteaux? (Le Feu, 158)

Maurice Genevoix
Les portraits de Genevoix sont aussi plus nuancés que ceux à l’emporte-pièce de Dorgelès car il évoque aussi bien la vieille femme sordide aux doigts crochus qui vend ses oeufs au prix fort que l’hôtesse jeune et alourdie d’enfants, qui leur prépare un lit de paille fraîche sur lequel elle a mis un matelas de plume, un traversin, des couvertures et des draps, ce qui pour les pauvres soldats accoutumés à dormir à la dure est le comble du bonheur.
Ici, et c’est un de mes passages favoris, on a une scène où la vie et le désir de vivre (comme on l’a vu si souvent exprimé dans les romans de poilus), se manifeste dans ses aspects les plus simples, drôles et cruels à la fois. La vie reconquise prend ici la forme d’un lit, c’est-à-dire de la chose la plus banale, redevenue une chose exceptionnelle :
Cette fois nous avons des draps, un vrai lit, un lit complet. Nous allons nous fourrer entre deux draps, déshabillés, en chemise, rien qu’avec nos chemises sur le corps. Je regarde Porchon du coin de l’oeil. Il a une bonne figure attendrie. Et soudain, il se tourne vers moi, met la main sur mon épaule, et, me regardant bien en face, à larges yeux affectueux, il dit:
-Chameau! (Ceux de 14, 131)
C’est avec le lit même, et certainement pas avec l’hôtesse, une blonde “pansue et boursouflée”, que les deux camarades font l’amour :
Notre coucher, ce soir-là, fut une belle chose. Dévêtus en un tour de main, nous avons plongé aux profondeurs de notre lit. Tout de suite, il nous a pris, de la tête aux pieds, d’un enveloppement total et doux. Et puis à notre tour, petit à petit, nous avons pris possession de lui. Notre surprise ne finissait pas: à chaque seconde c’était un ébahissement nouveau; nous avions beau chercher, de toute notre peau, un contact qui fut rude ou blessât, il n’était pas un coin qui ne fût souplesse et tiédeur.
Nos corps, qui se rappelaient toutes les pierres des champs, toutes les souches qui crèvent le sol dans les bois, et l’humidité grasse des labours, et l’âpre sécheresse des chaumes, nos corps meurtris, les nuits de bivouac, par les courroies de l’équipement, par les chaussures et le sac bosselé, par tout notre harnachement de nomades sans abris, nos corps à présent ne pouvaient s’habituer à tant de volupté reconquise en une fois. Et nous riions aux éclats; nous disions notre enthousiasme en phrases burlesques, en plaisanteries énormes, dont chacune provoquait à nouveau des rires qui n’avaient pas de fin. Et l’homme blond riait de nous voir rire, et sa femme riait, et les gosses riaient: il y avait du rire dans ce taudis. (Ceux de 14, 131)
Et l’épisode se termine par un choeur de rieuses, de femmes qui rient devant le spectacle décrit ainsi :
Puis la femme est sortie doucement. Lorsqu’elle est revenue, elle ramenait avec elle cinq ou six villageoises d’alentour. Et toutes ces femmes nous regardaient rire, dans notre grabat; et elles s’ébaudissaitent en choeur de ce spectacle phénoménal: deux pauvres diables de qui la mort n’avait pas encore voulu, deux soldats de la grande guerre qui s’étaient battus souvent, qui avaient souffert beaucoup, et qui déliraient de bonheur et qui riaient à la vie de toute leur jeunesse, parce qu’ils couchaient, ce soir-là, dans un lit. (Ceux de 14, 131-2)
La chute est magistrale, et c’est l’art de Genevoix (on n’entre pas à l’Académie Française--en 1947--pour rien!) de se servir de sa plume pour évoquer le caractère à la fois grandiose et dérisoire, tragique et comique, de ce que vivent deux hommes liés par des rapports d’amitié où la femme n’a de place que comme figurante ou observatrice hilare.
Il y aurait bien d’autres exemples à donner de la femme dans le roman poilu. J’ai choisi ces trois auteurs car ils ont survécu au passage du temps, alors que tant d’autres, à la mode entre 1914-18, sont passés aux oubliettes. J’ai tenté de montrer que, confrontés à une expérience pour laquelle rien ne les préparait, une expérience nouvelle, inédite, horrible sous tant d’aspects, ils ont tenté avec les moyens qu’ils avaient à leur disposition, le roman et ses clichés, de témoigner, comme le personnage de Poterloo dans Le Feu, afin que les “mauvais jours” ne reviennent plus.
Ici, et c’est un de mes passages favoris, on a une scène où la vie et le désir de vivre (comme on l’a vu si souvent exprimé dans les romans de poilus), se manifeste dans ses aspects les plus simples, drôles et cruels à la fois. La vie reconquise prend ici la forme d’un lit, c’est-à-dire de la chose la plus banale, redevenue une chose exceptionnelle :
Cette fois nous avons des draps, un vrai lit, un lit complet. Nous allons nous fourrer entre deux draps, déshabillés, en chemise, rien qu’avec nos chemises sur le corps. Je regarde Porchon du coin de l’oeil. Il a une bonne figure attendrie. Et soudain, il se tourne vers moi, met la main sur mon épaule, et, me regardant bien en face, à larges yeux affectueux, il dit:
-Chameau! (Ceux de 14, 131)
C’est avec le lit même, et certainement pas avec l’hôtesse, une blonde “pansue et boursouflée”, que les deux camarades font l’amour :
Notre coucher, ce soir-là, fut une belle chose. Dévêtus en un tour de main, nous avons plongé aux profondeurs de notre lit. Tout de suite, il nous a pris, de la tête aux pieds, d’un enveloppement total et doux. Et puis à notre tour, petit à petit, nous avons pris possession de lui. Notre surprise ne finissait pas: à chaque seconde c’était un ébahissement nouveau; nous avions beau chercher, de toute notre peau, un contact qui fut rude ou blessât, il n’était pas un coin qui ne fût souplesse et tiédeur.
Nos corps, qui se rappelaient toutes les pierres des champs, toutes les souches qui crèvent le sol dans les bois, et l’humidité grasse des labours, et l’âpre sécheresse des chaumes, nos corps meurtris, les nuits de bivouac, par les courroies de l’équipement, par les chaussures et le sac bosselé, par tout notre harnachement de nomades sans abris, nos corps à présent ne pouvaient s’habituer à tant de volupté reconquise en une fois. Et nous riions aux éclats; nous disions notre enthousiasme en phrases burlesques, en plaisanteries énormes, dont chacune provoquait à nouveau des rires qui n’avaient pas de fin. Et l’homme blond riait de nous voir rire, et sa femme riait, et les gosses riaient: il y avait du rire dans ce taudis. (Ceux de 14, 131)
Et l’épisode se termine par un choeur de rieuses, de femmes qui rient devant le spectacle décrit ainsi :
Puis la femme est sortie doucement. Lorsqu’elle est revenue, elle ramenait avec elle cinq ou six villageoises d’alentour. Et toutes ces femmes nous regardaient rire, dans notre grabat; et elles s’ébaudissaitent en choeur de ce spectacle phénoménal: deux pauvres diables de qui la mort n’avait pas encore voulu, deux soldats de la grande guerre qui s’étaient battus souvent, qui avaient souffert beaucoup, et qui déliraient de bonheur et qui riaient à la vie de toute leur jeunesse, parce qu’ils couchaient, ce soir-là, dans un lit. (Ceux de 14, 131-2)
La chute est magistrale, et c’est l’art de Genevoix (on n’entre pas à l’Académie Française--en 1947--pour rien!) de se servir de sa plume pour évoquer le caractère à la fois grandiose et dérisoire, tragique et comique, de ce que vivent deux hommes liés par des rapports d’amitié où la femme n’a de place que comme figurante ou observatrice hilare.
Il y aurait bien d’autres exemples à donner de la femme dans le roman poilu. J’ai choisi ces trois auteurs car ils ont survécu au passage du temps, alors que tant d’autres, à la mode entre 1914-18, sont passés aux oubliettes. J’ai tenté de montrer que, confrontés à une expérience pour laquelle rien ne les préparait, une expérience nouvelle, inédite, horrible sous tant d’aspects, ils ont tenté avec les moyens qu’ils avaient à leur disposition, le roman et ses clichés, de témoigner, comme le personnage de Poterloo dans Le Feu, afin que les “mauvais jours” ne reviennent plus.
En guise de conclusion
En définitive, je suis partie d’une idée, celle que ces écrivains poilus avaient tous une piètre opinion des femmes, qu’ils leur octroyaient la mauvaise part pour s’en réserver la bonne, pour me rendre compte, après une relecture de ces trois romans, que c’était bien plus compliqué, plus nuancé que cela.
Ce que j’ai découvert en lisant plus attentivement ces récits-romans-témoignages, ce sont les différences sous les stéréotypes, c’est le multiple sous l’uniforme : un Dorgelès drôle et cruel, sans pitié pour les femmes, mais attachant, même quand il en fait trop et donne dans le larmoyant; un Barbusse beaucoup plus nuancé, très humain, mais féroce pour les meneurs de guerre, annonçant le formidable Giono et son Grand troupeau; enfin un Genevoix qui peut tout se permettre et rachète tout par sa plume: à la fois des portraits mièvres et stéréotypés comme des portraits vifs et surtout vivants de femmes, et évoquer, comme Giono le fera par la suite avec ses personnages masculins, l’infini tendresse de l’homme poilu pour son camarade d’escouade.
En définitive, je suis partie d’une idée, celle que ces écrivains poilus avaient tous une piètre opinion des femmes, qu’ils leur octroyaient la mauvaise part pour s’en réserver la bonne, pour me rendre compte, après une relecture de ces trois romans, que c’était bien plus compliqué, plus nuancé que cela.
Ce que j’ai découvert en lisant plus attentivement ces récits-romans-témoignages, ce sont les différences sous les stéréotypes, c’est le multiple sous l’uniforme : un Dorgelès drôle et cruel, sans pitié pour les femmes, mais attachant, même quand il en fait trop et donne dans le larmoyant; un Barbusse beaucoup plus nuancé, très humain, mais féroce pour les meneurs de guerre, annonçant le formidable Giono et son Grand troupeau; enfin un Genevoix qui peut tout se permettre et rachète tout par sa plume: à la fois des portraits mièvres et stéréotypés comme des portraits vifs et surtout vivants de femmes, et évoquer, comme Giono le fera par la suite avec ses personnages masculins, l’infini tendresse de l’homme poilu pour son camarade d’escouade.
Comme les poilus qui sont accoutrés chacun à sa façon, et défient l’ordre venu d’en haut par un désordre mobile, ces romans sont tous différents quand on s’approche d’un peu plus près. Voici une scène typique dans Les Croix de bois, où le jeune Gilbert et les nouveaux arrivés de la troisième compagnie, cinquième escouade, regardent avec étonnement leurs futurs camarades de front, y compris le narrateur:
Eux aussi nous dévisageaient, comme s’ils étaient tombés chez les sauvages. Tout devait les étonner à cette première rencontre; nos visages cuits, nos tenues disparates, le bonnet de fausse loutre du père Hamel, le fichu blanc crasseux que Fouillard se nouait autour du cou, le pantalon de Vairon cuirrassé de graisse, la pélerine de Lagny, l’agent de liaison, qui avait cousu un col d’astrakan sur un capuchon de zouave, ceux-ci en veste de biffin, ceux-là en tunique d’artilleur, tout le monde accoutré à sa façon; le gros Bouffioux, qui portait sa plaque d’identité à son képi, comme Louis XI portait ses médailles, un mitrailleur avec son épaulière de métal et son gantelet de fer qui le faisait ressembler à un homme d’armes de Crécy, le petit Belin, coiffé d’un vieux calot de dragon enfoncé jusqu’aux oreilles et Broucke, “le gars de ch’Nord” qui s’était taillé des molletières dans les rideaux de reps vert. (Les Croix, 3)
Eux aussi nous dévisageaient, comme s’ils étaient tombés chez les sauvages. Tout devait les étonner à cette première rencontre; nos visages cuits, nos tenues disparates, le bonnet de fausse loutre du père Hamel, le fichu blanc crasseux que Fouillard se nouait autour du cou, le pantalon de Vairon cuirrassé de graisse, la pélerine de Lagny, l’agent de liaison, qui avait cousu un col d’astrakan sur un capuchon de zouave, ceux-ci en veste de biffin, ceux-là en tunique d’artilleur, tout le monde accoutré à sa façon; le gros Bouffioux, qui portait sa plaque d’identité à son képi, comme Louis XI portait ses médailles, un mitrailleur avec son épaulière de métal et son gantelet de fer qui le faisait ressembler à un homme d’armes de Crécy, le petit Belin, coiffé d’un vieux calot de dragon enfoncé jusqu’aux oreilles et Broucke, “le gars de ch’Nord” qui s’était taillé des molletières dans les rideaux de reps vert. (Les Croix, 3)
Et pour terminer ce défilé de mode militaire, quelques pages plus loin, un mariage improvisé où les hommes après avoir défoncé les armoires d’une grande chambre aux teintures claires, s’habillent en couple de mariés:
J’vas m’habiller en poule et toi en homme, tu piges, face d’âne?
Le temps de déchirer quelques corsages dans des essayages malheureux, et ils purent s’admirer dans la glace, transformés en mariés de mardi gras. Quand ils parurent dans la cour, bras dessus, bras dessous, ce fut une courte stupéfaction, puis une clameur les salua:
-Vive la noce! Hurla le premier Fouillard.
Les autres braillèrent plus fort, et l’escouade hurlant de joie entoura les deux chienlits. (Les Croix, 10)
Non seulement la guerre a séparé les sexes, et ce faisant accentué les caractéristiques animales des hommes, ces poilus boueux qui ne ressemblaient plus à des hommes, mais elle a aussi, en les séparant, brouillé les pistes, et faisant table rase de la différence des sexes, comme le montre Hemingway, a fait bouger les stéréotypes masculin/féminin. Le choeur des rieuses de Genevoix et celui des pleureurs de Dorgelès en sont des exemples, auxquels on peut ajouter le Poterloo de Barbusse, qui, par sa générosité et son ouverture d’esprit, peut se mettre à la place de l’autre, de la femme, comme de tout être vivant, c’est-à-dire de tout être qui veut vivre.
J’vas m’habiller en poule et toi en homme, tu piges, face d’âne?
Le temps de déchirer quelques corsages dans des essayages malheureux, et ils purent s’admirer dans la glace, transformés en mariés de mardi gras. Quand ils parurent dans la cour, bras dessus, bras dessous, ce fut une courte stupéfaction, puis une clameur les salua:
-Vive la noce! Hurla le premier Fouillard.
Les autres braillèrent plus fort, et l’escouade hurlant de joie entoura les deux chienlits. (Les Croix, 10)
Non seulement la guerre a séparé les sexes, et ce faisant accentué les caractéristiques animales des hommes, ces poilus boueux qui ne ressemblaient plus à des hommes, mais elle a aussi, en les séparant, brouillé les pistes, et faisant table rase de la différence des sexes, comme le montre Hemingway, a fait bouger les stéréotypes masculin/féminin. Le choeur des rieuses de Genevoix et celui des pleureurs de Dorgelès en sont des exemples, auxquels on peut ajouter le Poterloo de Barbusse, qui, par sa générosité et son ouverture d’esprit, peut se mettre à la place de l’autre, de la femme, comme de tout être vivant, c’est-à-dire de tout être qui veut vivre.
En guise de conclusion, je terminerai par cet extrait du Feu de Barbusse. C’est toujours Poterloo qui, dans un langage sans ornements, avec ses répétitions et ses fautes de français, parle de la femme qu’il aime et qui pourtant va l’oublier parce que le temps passe et que la guerre n’en finit plus:
C’est la vie. Elle vit. Eh oui, elle vit, voilà tout. C’est pas d’sa faute si elle vit. Tu voudrais pas qu’elle meure? Alors qu’est-ce que tu veux qu’elle fasse? Qu’elle pleure, rapport à moi et aux Boches, tout le long du jour? Qu’elle rouspète? On peut pas pleurer tout le temps ni rouspéter pendant dix-huit mois. C’est pas vrai. Il y a trop longtemps, que j’te dis. Tout est là. (Le Feu, 231)
Comme la guerre doit finir, ainsi ma conférence.
C’est la vie. Elle vit. Eh oui, elle vit, voilà tout. C’est pas d’sa faute si elle vit. Tu voudrais pas qu’elle meure? Alors qu’est-ce que tu veux qu’elle fasse? Qu’elle pleure, rapport à moi et aux Boches, tout le long du jour? Qu’elle rouspète? On peut pas pleurer tout le temps ni rouspéter pendant dix-huit mois. C’est pas vrai. Il y a trop longtemps, que j’te dis. Tout est là. (Le Feu, 231)
Comme la guerre doit finir, ainsi ma conférence.
[1] Antoine Compagnon, La Grande Guerre des écrivains: d’Apollinaire à Zweig, Paris: Gallimard, Folio Classiques, 2014, 14.
2 “Centenaire de la guerre de 14: Paroles de Poilus, lettres, croquis, dessins et carnets de front”, Bibliothèque Municipale de Saint Jean-le-Thomas, allée des pruniers, juillet-août 2014.
3 Le Pays Manslois: d’une guerre à l’autre, 1870-1918, Pierre Ramblière et Yvette Renaud éds., Foyer des Arts et Loisirs, Presses de Composervices, 2008, tome 2.
4 “En France, le concept d’écrivain combattant apparaît dans les premiers mois de la guerre et se généralise après 1918.” Nicolas Beaupré, Ecrits de guerre: 1914-1918, Paris: CNRS Editions, 2013, 15. Jean Norton Cru, ancien combattant lui-même, dans Témoins (publié en 1930), fit la guerre aux romans de la guerre qu’il jugeait inauthentiques, écrits pour produire des effets littéraires. Il juge Ceux de 14 admirable et disqualifie presque tous les autres romans, y compris ceux de Barbusse et Dorgelès. Voir A. Compagnon, op. cit., 22.
5 Le prix Goncourt décerné en 1915 à René Benjamin pour son roman Gaspard qui propose une vision idyllique de la guerre, est décerné en 1916 à Henri Barbusse pour Le Feu qui en propose une version diamétralement opposée, signe sans doute que l’opinion publique est en train de changer. Voir “Les écrivains et la guerre”, in Jean-Jacques Becker, Les Français dans la Grande Guerre, Paris: Laffont, 1980. 153-7.
6 Toutes les citations se réfèrent aux éditions suivantes et seront indiquées entre parenthèses:
Henri Barbusse, Le Feu, Paris: Gallimard, Folio, 2013; Raymond Dorgelès, Les Croix de bois, Paris: Albin Michel, 1930 (164e mille); Maurice Genevois, Ceux de 14, Paris: Omnibus, 1998.
7 Cité par A. Compagnon, op. cit., 329-30.
8 En 1914, le terme “poilu” existe depuis un siècle et était employé pour les soldats de la Grande Armée de Napoléon 1er. Mais il ne devient vraiment populaire qu’avec la Grande Guerre pour désigner les simples soldats du front, à qui manquait l’eau pour se raser.
9 “Centenaire de la guerre de 14”, Bibliothèque Municipale de Saint Jean-le-Thomas.
2 “Centenaire de la guerre de 14: Paroles de Poilus, lettres, croquis, dessins et carnets de front”, Bibliothèque Municipale de Saint Jean-le-Thomas, allée des pruniers, juillet-août 2014.
3 Le Pays Manslois: d’une guerre à l’autre, 1870-1918, Pierre Ramblière et Yvette Renaud éds., Foyer des Arts et Loisirs, Presses de Composervices, 2008, tome 2.
4 “En France, le concept d’écrivain combattant apparaît dans les premiers mois de la guerre et se généralise après 1918.” Nicolas Beaupré, Ecrits de guerre: 1914-1918, Paris: CNRS Editions, 2013, 15. Jean Norton Cru, ancien combattant lui-même, dans Témoins (publié en 1930), fit la guerre aux romans de la guerre qu’il jugeait inauthentiques, écrits pour produire des effets littéraires. Il juge Ceux de 14 admirable et disqualifie presque tous les autres romans, y compris ceux de Barbusse et Dorgelès. Voir A. Compagnon, op. cit., 22.
5 Le prix Goncourt décerné en 1915 à René Benjamin pour son roman Gaspard qui propose une vision idyllique de la guerre, est décerné en 1916 à Henri Barbusse pour Le Feu qui en propose une version diamétralement opposée, signe sans doute que l’opinion publique est en train de changer. Voir “Les écrivains et la guerre”, in Jean-Jacques Becker, Les Français dans la Grande Guerre, Paris: Laffont, 1980. 153-7.
6 Toutes les citations se réfèrent aux éditions suivantes et seront indiquées entre parenthèses:
Henri Barbusse, Le Feu, Paris: Gallimard, Folio, 2013; Raymond Dorgelès, Les Croix de bois, Paris: Albin Michel, 1930 (164e mille); Maurice Genevois, Ceux de 14, Paris: Omnibus, 1998.
7 Cité par A. Compagnon, op. cit., 329-30.
8 En 1914, le terme “poilu” existe depuis un siècle et était employé pour les soldats de la Grande Armée de Napoléon 1er. Mais il ne devient vraiment populaire qu’avec la Grande Guerre pour désigner les simples soldats du front, à qui manquait l’eau pour se raser.
9 “Centenaire de la guerre de 14”, Bibliothèque Municipale de Saint Jean-le-Thomas.
 Accueil
Accueil La Femme dans le roman de la Grande Guerre : texte de la conférence
La Femme dans le roman de la Grande Guerre : texte de la conférence